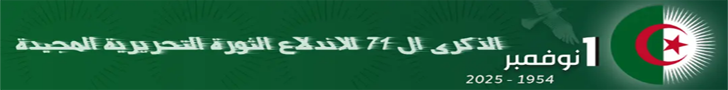Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ordre international repose sur une promesse fondatrice: substituer la force du droit au droit de la force. La Charte des Nations unies, le Conseil de sécurité, le principe de souveraineté et l’interdiction du recours unilatéral à la force constituaient autant de garde-fous destinés à empêcher le retour aux logiques de prédation étatique qui avaient plongé le monde dans la catastrophe. Or, force est de constater que cette architecture est aujourd’hui profondément fragilisée. L’un des symptômes les plus préoccupants de cet effritement est la banalisation des interventions militaires sans mandat onusien, en particulier lorsqu’elles sont décidées par la première puissance militaire mondiale. Sous la présidence de Donald Trump, les exemples se sont multipliés : assassinat ciblé du général iranien Qasem Soleimani près de l’aéroport de Bagdad sans autorisation du Conseil de sécurité, frappes de missiles contre la base syrienne de Shayrat en 2017, raid meurtrier au Yémen quelques jours après son entrée en fonction ou encore bombardements en Iran lors de la courte guerre Iran–Israël de juin 2025. Ces actions, quelles que soient les justifications avancées a posteriori, s’inscrivent hors du cadre réglementaire prévu par le droit international. Le problème n’est pas seulement juridique; il est systémique. Lorsqu’un État se réserve le droit de frapper, d’éliminer ou de punir un autre État ou ses représentants sans contrôle multilatéral, il ne fait pas qu’enfreindre une règle : il affaiblit l’ensemble de l’édifice légal. Le message envoyé est limpide: la légalité internationale devient optionnelle pour les puissants, contraignante uniquement pour les faibles. Dans ces conditions, pourquoi d’autres États se priveraient-ils de recourir à la force lorsqu’ils estiment leurs intérêts menacés? Certes, les défenseurs de ces interventions invoquent la légitime défense, la lutte contre le terrorisme ou la prévention de menaces futures. Mais le droit international n’a jamais été conçu pour fonctionner sur la base de jugements unilatéraux. La Charte de l’ONU encadre strictement la légitime défense, et celle-ci ne saurait devenir une autorisation automatique permettant toutes les frappes préventives. En se substituant aux instances collectives, les États qui agissent seuls, transforment la norme en simple déclaration de bonne intention. Cela ne signifie nullement qu’il faille fermer les yeux sur les régimes autoritaires. Le Venezuela de Nicolas Maduro en est un exemple frappant. La dérive dictatoriale du pouvoir, l’effondrement économique, la répression politique et la gestion catastrophique des ressources ont plongé la population dans une crise humanitaire majeure. Le régime porte une responsabilité écrasante dans la destruction de l’État de droit et la misère sociale. Mais cette réalité, aussi accablante soit-elle, ne confère aucun droit acquis d’agression militaire à des puissances extérieures. Précisément, les institutions internationales ont été créées pour éviter que chaque État ne se fasse juge, jury et bourreau. Leur affaiblissement actuel tient autant à leur paralysie qu’au mépris croissant dont elles font l’objet. Lorsqu’un président américain agit «à sa tête», sans mandat, sans consensus et sans reddition de comptes internationale, il adopte une posture qui, paradoxalement, s’apparente à celle qu’il prétend combattre: la concentration du pouvoir de l’arbitraire. L’inquiétude est donc légitime. Non parce que le droit international serait parfait — il ne l’a jamais été — mais parce que son démantèlement progressif ouvre la voie à un monde où la puissance militaire prime sur la règle commune. Un monde où les grandes puissances s’autorisent ce qu’elles interdisent aux autres, est un monde instable, dangereux et fondamentalement injuste. À terme, ce sont précisément les plus vulnérables qui en paieront le prix et l’humanité tout entière avec eux.
Effritement du droit international: La force du droit ou le droit de la force?
- par A. Benani
- Le 05 Janvier 2026
- 361 visites